Lu dans la presse : 2012, l’année terrible
Dans le dernier numéro de la revue Eléments (octobre-décembre 2011), Alain de Benoist, dans un article intitulé « L’année 2012 sera terrible ! », analyse la crise économique et de la responsabilité du secteur bancaire et de la finance dans la crise qui menace aujourd’hui les Etats. Même si l’on peut ne pas partager ses conclusions trop socialiste, sa réflexion est intéressante à plus d’un titre.
« La cause immédiate de l’aggravation des dettes publiques, écrit-il, tient aux plans de sauvetage des banques privées décidées par les Etats en 2008 et 2009. Les banques ont forcé les pouvoirs publics à les secourir en faisant valoir la place névralgique qu’elles occupent dans la structure générale du système capitaliste. Pour renflouer les banques et les compagnies d’assurances menacées, les Etats, pris en otages, ont dû emprunter à leur tour sur les marchés, ce qui a accru leur dette dans des proportions insupportables. Des sommes astronomiques (800 milliards de dollars aux Etats-Unis, 117 millions de livres en Grande-Bretagne) ont été dépensées pour empêcher ces banques de sombrer, ce qui a grevé d’autant les finances publiques. Au total, les quatre principales banques centrales mondiales (Réserve fédérale, Banque centrale européenne, Banque du Japon et Banque d’Angleterre) ont injecté 5 000 milliards de dollars dans l’économie mondiale entre 2008 et 2010. C’est le plus grand transfert de richesse de l’histoire du secteur public vers le secteur privé ! En s’endettant massivement pour sauver les banques, les Etats ont permis aux banques de se relancer immédiatement dans les mêmes activités qui avaient abouti précédemment à les mettre en péril. Mais ils se sont d’eux-mêmes placés sous la menace des marchés et des agences de notations. »
Non seulement les banque n’en ont montré aucune reconnaissance, mais elles en ont profité pour renouer avec des profits faramineux :
« La mainmise de la nouvelle oligarchie financière sur l’économie mondiale n’a donc cessé de se renforcer malgré la crise. En témoignent les profits de ces mêmes banques qui, en 2008, avaient fait le siège des Etats pour demander qu’on les aide à échapper à la faillite. En 2009, soit après le choc financier de l’année précédente, la totalité des actifs des six principales banques américaines (…) a représenté plus de 60 % du PNB national, alors qu’ils n’en représentaient encore que 20 % en 1995 ! »
Les conséquences de la dérégulation
Ces profits ont été autorisés à la fois par les politiques de dérégulation et par la spéculation :
L’augmentation de l’influence des lobbies financiers sur le personnel politique a entraîné la dérégulation progressive des marchés financiers, qui a elle-même provoqué l’explosion des gains spéculatifs drainant le capital hors de la sphère productive. Le libre-échangisme de son côté a favorisé la concurrence déloyale des pays associant salaires minimaux et productivité élevée. La dérégulation, obéissant à la logique du marché mondialisé comme aux exigences de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), a abouti dès 1999 à la suppression de toute barrière douanière significative et à l’abolition de fait de la préférence communautaire en Europe. La vitesse à laquelle le capital financier et les capitaux spéculatifs peuvent désormais entrer ou sortir des économies particulières a encore accru la volatilité des prix des actifs et la gravité des conséquences de la crise. »
Alain de Benoist en énumère les conséquences :
-
multiplication des délocalisations, désindustrialisation, baisse des salaires, précarité de l’emploi, hausse du chômage ;
-
fuite des capitaux : « en France, entre 2000 et 2008, 388 milliards d’euros, soit une moyenne de 48,5 milliards d’euros par an (ce qui correspondait en 2008 à 2,5 % du PIB), ont pris le chemin de l’étranger ». (Ce qui pose, soit dit en passant, le problème de la disparition du patriotisme, beaucoup oubliant la dette morale essentielle qu’ils ont envers leur pays ) ;
-
l’installation « d’une économie de casino, qui a systématiquement favorisé les revenus des spéculateurs au détriment des consommateurs et parfois même des producteurs » ;
-
la collusion entre les marchés financiers et l’industrie du crime, décrite par le criminologue Xavier Raufer : « Du fait de la dérégularisation mondiale, puis de la crise, l’économie illicite (grise ou noire) qui, vers 1980, constituait quelque 7 % du produit brut mondial, en représentait en 2009 sans doute 15 % soit l’équivalent du PNB de l’Australie). » ;
-
la désindustrialisation, « provoquée par la déconnection de l’économie réelle et de l’économie financière, et l’explosion des gains spéculatifs qui en résulte. Dans l’ensemble des pays membres de l’OCDE, quelque 17 millions d’emplois industriels ont été détruits en l’espace de seulement deux ans, dont 10 millions dans les secteurs manufacturiers. »
Si les Etats ont volé au secours des banques, et à travers elles du système économique, il s’en faut donc de beaucoup que l’inverse soit vrai :
« Depuis deux ans, la guerre financière menée par les spéculateurs et les investisseurs institutionnels contre les Etats bat son plein », écrit Alain de Benoist. Pour ma part, je ne souscris pas à cette phrase. Pour que le monde de la finance engage la lutte avec les Etats, encore faudrait-il qu’il y ait une « volonté belligérante ». Je crois qu’il faut parler, plutôt que de guerre, de parasitisme – et l’on sait que certains parasites finissent par tuer l’organisme sur lequel ils vivent et dont ils se nourrissent. Il en est ainsi de l’économie fictive, prête à tuer l’économie réelle dont elle tire pourtant ses bénéfices.
« Les attaques sur les marchés financiers prennent la forme d’une hausse directe ou indirecte des taux d’intérêt que les pays doivent payer pour emprunter. Les indications fournies par les agences de notation déterminent les cibles et la stratégie à adopter. (…) Le problème qui se pose est celui de leur indépendance, puisqu’elles sont financées par les mêmes établissements dont elles évaluent la solvabilité : ce sont les banques qui les payent pour évaluer leurs produits. »
Par ailleurs, « une grande partie des dettes publiques se trouve aujourd’hui dans les comptes des banques qui n’ont cessé d’en acheter depuis 2008, sans se préoccuper outre mesure de la fragilité des finances publiques aggravée par la récession et la crise. Ces achats de dette publique ont été financé par l’argent que les banques pouvaient se procurer auprès de la Banque centrale européenne (BCE) à un prix quasi-nul. En d’autres termes, les banques ont prêté aux Etats, à un taux d’intérêt variable, des sommes qu’elles ont elles-mêmes empruntées pour presque rien. Mais pourquoi les Etats ne peuvent-ils pas se procurer eux-mêmes les sommes en question auprès de la Banque centrale ? Tout simplement parce que cela leur est interdit ! »
En effet, le 3 janvier 1973, le gouvernement français a fait adopter, sur proposition de Valéry Giscard d’Estaing alors ministre des Finances, une loi de réforme des statuts de la Banque de France interdisant à celle-ci de prêter (par définition sans intérêt) à l’Etat. Depuis, cette mesure a été généralisée dans toute l’Europe par les traités de Maastricht (art. 104) et de Lisbonne (art. 123). L’Etat se trouve donc « obligé d’emprunter sur les marchés financiers aux taux d’intérêt que ceux-ci jugent adéquats », tandis que les banques privées peuvent continuer d’emprunter à la Banque centrale européenne à un taux dérisoire (moins de 1 %) pour prêter aux Etats à un taux variant entre 3,5 et 7 % !
Ces mêmes banques n’en sont pourtant pas sauvée pour autant, menacées qu’elles sont par un possible défaut des Etats, comme on le voit en Grèce où « les banques allemandes et françaises sont les plus exposées. Fin 2010, les établissements français possédaient déjà dans leurs bilans 15 milliards de dette publique grecque (…). Sauver la dette grecque revient alors à sauver les banques françaises (…). La France emprunte donc auprès des banques de l’argent qui sera donné à la Grèce pour rembourser les banques ! Situation quasi surréaliste. Mais on mesure du même coup quelles seraient, pour les établissements financiers français, les conséquences d’une faillite définitive de la Grèce. Si le défaut de paiement se propageait à d’autres pays, l’ensemble du système bancaire européen pourrait se retrouver en défaut de paiement. »
Pour le système financier comme pour les politiques, le sauvetage du système devient prioritaire. Au sommet de Bruxelles, écrit encore Alain de Benoist, « le sauvetage de l’économie grecque a été conçu de façon telle à épargner le plus possible les grandes banques » au détriment des contribuables. « En contrepartie de l’aide apportée à la Grèce, les institutions européennes et le FMI ont exigé de ce pays des plans d’austérité et d’économie drastiques », qui se devraient se traduire par une baisse du pouvoir d’achat de près de 40 % : « un coût social qu’aucun peuple n’a jamais eu à subir en temps de paix ».
En outre, la part de la dette grecque aux mains des contribuables étrangers passera de 26 % en 2010 à 64 % en 2014 : « on s’oriente vers la vente à l’encan des biens du pays ».
Or la situation de la Grèce peut s’étendre à d’autres pays, plus importants : l’Espagne et l’Italie, voire la France ou la Grande-Bretagne pourraient entrer à leur tour « dans la zone des tempêtes ».
« On ne voit pas, compte tenu des dégâts provoqués à eux seuls par l’affaire grecque, comment les institutions européennes pourraient faire face à une série de défauts souverains, successifs ou simultanés, de beaucoup plus grande ampleur », constate lucidement Alain de Benoist, qui en conclut qu’« En dépit de toutes les manœuvres de retardement, une explosion généralisée semble inéluctable d’ici à deux ans. »











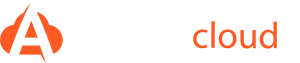
Comments (1)
tiens , tiens les économistes "socialisants" se rapprochent "dangereusement " de leurs confrères de la droite qu’ils qualifient eux mêmes d’extrême (cf les articles d’économie de RIVAROL) , mais qui ,eux , avaient été lucides bien plus tôt …
conclusion :
il faut laisser aux banques la possibilité de…faire faillite
c’est la seule "morale" qui les fera rentrer dans les clous !