Les néolibéraux contre les contribuables
La crise américaine s’étend, dure et devient chaque jour plus caricaturale, comme je l’écris depuis deux ans. Le système mis en place par les républicains, qui refuse le salaire minimum, la santé pour tous ou la protection des plus faibles, ne cesse de renflouer à coups de centaines de milliards de dollars les richissimes imprudents qui insultaient, il y a encore peu, les États européens.
Le néo-libéralisme a fait de la démocratie une ploutocratie aussi sotte qu’une cour d’ancien régime, avec l’appui des médias tous vendus aux groupes surpuissants de la communication. Je rappelle tout de même que Cobden avait fait voter les corn laws jadis pour faire baisser le prix du pain pour les pauvres, et que Frédéric Bastiat, qui siégeait à gauche, voulait plus de libéralisme pour aider les classes populaires et dépasser une économie d’ancien régime qui promettait de passer directement au socialisme de Louis Blanc.
Mais, avec le néo-libéralisme, nous n’en sommes plus là. Les néo-libéraux et leurs alliés néocons n’ont pas lu Milton Friedman ; ils veulent moins de recettes pour l’État, plus de richesses pour les ultra-riches, mais malheureusement aussi plus de dépenses. Plus de dépenses policières et de sécurité, plus de dépenses militaires aussi, puisqu’après la guerre contre l’Irak et l’Afghanistan, il faut aussi se préparer à une guerre contre l’Iran et la Russie. Comme disent Bill Bonner ou Thomas Friedman, on aurait préféré sauver Atlanta plutôt que Tbilissi, et donner un milliard aux familles ruinées de la Géorgie américaine plutôt qu’à celles de la Géorgie de Sakashvili. Mais il faut croire que c’était trop compliqué…
Les néo-libéraux adorent se référer à l’image de la vitre brisée de Bastiat. Chiche ! Une guerre à mille milliards de dollars, cela n’a peut-être pas d’effets pervers sur l’économie ? Une attitude folle de la FED qui a pratiqué une politique de prêts ridiculement conciliante et a incité au surendettement des ménages, cela n’a pas d’effets sur l’économie ? Une politique qui fait tout délocaliser, même l’agriculture, pour ne rêver de vivre que de la finance et de l’immobilier pour devenir riche à bon « conte », cela n’a pas de conséquences sur l’économie ? Une politique qui refuse d’investir dans l’éducation ou la maîtrise de l’immigration clandestine (elle fait baisser les salaires…), mais compte maintenant trois millions de prisonniers gardés par des surveillants surpayés, cela n’a pas de conséquences sur l’économie ?
C’est bien de ne pas vouloir payer pour l’éducation, la santé ou le reste : mais il faut en assumer le prix. Et c’est bien de vouloir casser la gueule à la planète jugée antidémocratique : mais il faut en assumer le prix.
Je m’amuse du Pérou à voir que les États-Unis de Bush ne comptent plus pour rien ici : on vire leurs ambassadeurs, on organise des réunions au sommet, on demande aux yankees de garder leurs distances, puisque le commerce du futur se fera de toute façon avec l’Asie.
Abby Cohen disait, peu avant le krach du printemps 2001, que les actions ne pouvaient pas monter jusqu’au ciel. Sans doute le prix des maisons le pouvait-il ? Et hop un appartement sur le toit du Pierre pour 70 millions de dollars, et un hop un chalet à Aspen vendu 130 millions de dollars. Et tous de se voir milliardaires simplement en regardant monter le cours de l’immobilier sur le web. Un éléphant, cela « trump » pourtant énormément…
La bacchanale financière des années 2000 a été dix fois pire que celle des années 80. Ses conséquences seront dix fois pires. Il avait fallu 4 milliards de dollars pour sauver LTMC, il y a une décennie. Là, il faut cent fois plus. Et c’est le contribuable américain, déjà ruiné par les guerres et ses dettes immobilières, qui va payer les pots cassés… Après tout, il a l’air soumis comme un moujik, alors autant en profiter !
Quant au dollar, dont Nixon disait cyniquement : C’est notre monnaie, mais c’est votre problème, là, il devient, plus que la Géorgie ou le Hezbollah, le problème américain !











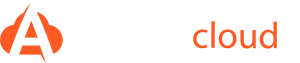
Comments (8)
Bravo Mr.Maudet. Il y a en effet une grande différence entre un patron qui a créé son entreprise et un manager qui a été choisi pour diriger une entreprise ne lui appartenant pas.
S’il faut limiter les abus c’est bien parmi les managers qui ne sont intéressés que par leur carrière ainsi que par la volonté d’y faire fortune aussi vite que possible.
Si les patrons continuent à être assimilés à des managers par amalgame, nul doute qu’il n’y aura bientôt plus de postulants et le chômage continuera à s’accroître.
Il y en a un peu marre d’entendre parler de "limitations de salaires" des PATRONS !
"Patron" est très mal employé pour définir dans ce cas : (limitations de salaires – parachutes dorés – stock options – etc) ce qui ne sont que des Directeurs Généraux ou des Présidents Directeurs Généraux, qui (généralement) n’ont que quelques acttions (ou pas du tout) dans l’entreprise.
Un vrai patron c’est non seulement le dirigeant – mais aussi et avant tout le PROPRIETAIRE de son entreprise.
Allez donc demander à Bill GATES ou à S.R. WALTON ce qu’il penserait d’un encadrement de leurs salaires : ils vous riraient au nez en vous répondant (à juste titre) : "chez MOI je fais ce que je veux"…
Messieurs les journalistes arrêtez de galvauder le terme de "patron" – utilisez plutôt celui de "haut dirigeant d’entreprise" quand il s’agit de PDG d’entreprises importantes…
Jacques MAUDET
PHOENIX, Arizona (Reuters) – Si, par tradition, les Américains accordent une grande valeur au culte de la richesse individuelle, le débat sur le plan de sauvetage des banques conduit aujourd’hui une partie d’entre eux à s’interroger sur les hauts salaires des patrons d’entreprises.
L’an dernier, les dirigeants des groupes cotés dans l’indice Standard & Poor’s 500 ont touché en moyenne 10,5 millions de dollars, ce qui représente 344 fois le revenu moyen d’un salarié américain, selon l’Institute for Policy Studies (IPS) et Unis pour une économie juste, deux organisations spécialisées dans les questions de justice sociale.
"C’est un sujet qui choque les gens quelle que soit leur opinion politique", souligne Sarah Anderson, chercheuse à l’IPS.
Jusqu’à présent, la reconnaissance des talents dans un environnement international concurrentiel était la raison avancée pour justifier les fortes rémunérations des dirigeants.
Mais avec la crise financière et l’appel à la rescousse du contribuable pour réparer les erreurs de Wall Street, le ton a changé.
"Je ne crois pas que ce soit juste. Je ne crois pas qu’on puisse justifier le versement de telles primes, en particulier quand c’est une prime à l’échec", estime Paul Pisinski, directeur de la santé publique du Massachusetts.
Alan Smythe, vendeur sur les marchés au Texas, ironise: "Ils ont donné 40 millions de dollars à ce type (d’AIG). Donnez-moi un million et je mets la société sur les genoux encore plus vite. Je le fais en six mois."
IMPUISSANCE
Les deux candidats à la Maison blanche, Barack Obama et John McCain, ont bien conscience de l’émergence du débat et se sont tous les deux prononcés pour la limitation des salaires des dirigeants, alors que la campagne pour la présidentielle du 4 novembre est entrée dans sa dernière ligne droite.
Le plan de 700 milliards de dollars proposé par le secrétaire au Trésor, Henry Paulson, pour sauver le système financier a été amendé par le Congrès.
Le texte prévoit désormais de bloquer le versement de primes aux dirigeants ayant pris de mauvaises décisions. Il plafonne les indemnités de départ, les fameux "parachutes dorés" qui font aussi débat en France.
Ces mesures doivent contribuer à apaiser la colère des électeurs, mais ces derniers reconnaissent eux-mêmes que les moyens d’encadrer les rémunérations patronales sont limités.
Si les actionnaires protestent régulièrement contre les primes accordées aux dirigeants, Marsha Minniss, qui enseigne le design en Arizona, souligne que "laisser la question aux actionnaires, qui se préoccupent avant tout de leur propre profit, ne nous a menés nulle part".
Darlene Dexter, une habitante de Cincinnati âgée de 50 ans, avoue son impuissance. "Que ceux qui travaillent dur et lancent leur propre entreprise gagnent beaucoup d’argent, tant mieux. Mais s’ils ne font pas du bon travail, alors non."
Mais, ajoute-t-elle, "je n’aime pas trop d’intervention du gouvernement. C’est difficile, je ne vois pas de réponse. Je souhaiterais juste que les dirigeants aient une conscience et prêtent attention aux personnes qui travaillent pour eux."
Version française Jean-Stéphane Brosse
Paris, France
Vendredi 03 Octobre 2008
=============================
*** J.C. Trichet détecte enfin des "incertitudes"
C’est carrément sans précédent…
*** Félicitations aux survivants !
Cette semaine a été l’une des pires de ces 21 dernières années, pour les actions
*** Le ciel nous tombe sur la tête
Mais les politiciens ont gagné…
*** Passez entre les blitz, prenez vos gains et sortez !
La situation actuelle est insensée, la prudence est de mise
——————————————————
Mettez [email protected] dans votre carnet d’adresse pour éviter les filtres Spam qui en empêcheraient la réception.
——————————————————
Bonjour,
*** J.C. TRICHET DETECTE ENFIN DES "INCERTITUDES"
** La séance du 29 septembre, placée sous le signe du rejet du plan de renflouement, restera gravée dans les mémoires comme un nouveau lundi noir… tandis que la séance du 2 octobre — qui a vu une partie du Congrès US voter le plan Paulson reloaded — a rapidement pris l’apparence d’un jeudi gris foncé : -350 points sur le Dow Jones au final, -4,5% sur le Nasdaq, -4% sur le S&P 500. A moins d’un spectaculaire rebond ce vendredi, le recul hebdomadaire des indices américains pourrait être compris entre 8% et 9% (ce serait la pire semaine depuis la mi-septembre 2001).
Les indices américains s’étaient engagés résolument sur la mauvaise pente dès les premiers échanges ; ils n’ont ensuite cessé de se dégrader, sur la foi de sondages faisant état du plus profond pessimisme des investisseurs jamais mesuré depuis 50 ans. Il faut dire que depuis une semaine, les opérateurs qui ressortent du New York Stock Exchange vers 18 h — une fois répondu aux derniers ordres de leurs clients, rangé leur badge et remis leur veste sur les cintres — ont le bourdon. Ils se font copieusement huer chaque soir par une foule en colère qui crie son dégoût pour le gigantesque gâchis qui s’étale à la une de la presse et plonge les Etats-Unis dans le chaos.
Moins d’un an auparavant, alors que le S&P 500 et le Dow Jones s’apprêtaient à battre les records historiques (c’était autour du 15 octobre 2007 si notre mémoire est bonne), tous ces gars qui s’enfuient de Wall Street, la tête rentrée dans les épaules ou cachés derrière leur journal, étaient les héros de l’Amérique.
La plupart des manifestants d’aujourd’hui rêvaient alors de voir au moins un de leurs enfants embauchés dans le "Saint des Saints" du capitalisme, et peut-être même dans une salle de marché pour les sujets les plus brillants.
Alors que certains jeunes récemment embauchés par le NYSE n’ont pas encore fini de rembourser leurs études, les voici sommés de rendre leurs bonus (pour peu qu’ils portent une cravate correctement nouée et un costume de bonne facture). Les fossoyeurs du système arborent en effet des complets griffés à 3 000 $ et des chemises sur mesure… mais personne ne connaît leur tête, ni leurs clients, ni leurs collègues du back office, et encore moins les sans-grades des étages inférieurs (ceux qui relancent les emprunteurs se retrouvant à découvert).
Les manifestants ne risquent pas de croiser des golden boys en goguette en train de déguster une part de pizza entre copains sur une pelouse de Central Park : soit ils ne prennent pas de pause déjeuner quand ça chauffe, soit ils prennent tout leur temps. Ils réservent alors des tables dans les restaurants les plus exclusifs de Manhattan et y dégustent de grands crus qui valent le prix d’un aller-retour Paris-New York en classe affaire.
Aujourd’hui, les mêmes golden boys rasent les murs lorsqu’ils croisent les agents de sécurité qui assurent le gardiennage des parkings, et ils empruntent la vieille Toyota de leur femme (toute heureuse de récupérer la Porsche) pour ne pas se faire remarquer lorsqu’ils circulent dans New York.
** Les acheteurs rasaient également les murs à Paris en fin de séance jeudi sous le signe d’une rafale de dégagements de précaution (-2,25%). Cela aurait cependant pu être pire, dans la mesure où le Nasdaq chutait déjà de 3% et le Dow Jones de 2,5% au moment de la clôture des marchés européens (-2% en moyenne).
Les investisseurs américains se focalisaient à nouveau sur des fondamentaux guère souriants, et qui avaient été négligés la veille. Il s’agit notamment de l’effondrement des ventes d’automobiles en septembre, de la chute de 4% des commandes à l’industrie ce jeudi et du plongeon de 10% de l’indice ISM manufacturier la veille, sous le seuil des 50… Sans oublier le million de logements saisis et le taux record de 2,75% des défauts de paiement sur des emprunts hypothécaires.
** Oui vraiment, les perspectives économiques semblent sombres. Même Jean-Claude Trichet le reconnaît puisqu’il déclare que le degré des incertitudes qui pèsent sur nos économies est "sans précédent", tandis que de nombreux signes de ralentissement ont amené les membres de la BCE à examiner la question d’une baisse de taux. Une initiative en ce sens a cependant été rejetée à l’unanimité du conseil.
Les cambistes ont cependant validé l’hypothèse d’une baisse de taux avant la fin de l’année ; c’est ce qui explique la dégringolade de 2% de l’euro jeudi, avec un nouveau plancher annuel inscrit à 1,3750 $. En d’autres temps, la fermeté du billet vert se serait traduite par une hausse proportionnelle du CAC 40, mais le credit crunch gèle toute initiative de la part des investisseurs américains.
** Paris a clôturé ce jeudi juste en-deçà des 4 000 points, à proximité des plus bas testés le 18 septembre dernier. Compte tenu des 15% repris par le dollar en trois mois, le marché parisien vous apparaît-il survendu à ce niveau ? Permettez-nous d’en douter !
En effet, un CAC 40 naviguant entre 3 960 points et 4 100 points, cela nous ramène à mai 2005 — avec un Dow Jones oscillant entre 10 500 et 11 200 points à la mi-août 2006. C’est-à-dire une époque où la valeur des biens immobiliers progressait de 10% à 15% par an, où les profits des entreprises s’envolaient de 20% en rythme annuel, où l’inflation était contenue en-deçà des 2% malgré un pétrole qui se négociait entre 60 $ et 70 $ le baril.
Oui, une époque bénie où tous les voyants économiques et boursiers étaient au vert, illustrant la parabole du Goldilocks, un équilibre rêvé entre risque de surchauffe inflationniste et risque de ralentissement de l’activité.
A deux ou trois ans de distance, les indices boursiers affichent toujours des niveaux de valorisation "hédonistes" alors que la situation actuelle serait, de l’avis de dix Prix Nobel américains (d’ailleurs tous opposés au Plan Paulson), d’une gravité seulement comparable à la crise de 29.
Devant nous se dresse le trou noir des pertes d’un montant inconnu cantonnées dans des structures offshore — qui s’ajouteront inexorablement aux 1 000 milliards de dollars de pertes déjà recensées dans les comptes des banques sous surveillance d’autorités de régulation gouvernementales. Se dessinent aussi des courbes de croissance (PIB, PNB) en chute libre, et un credit crunch aussi sévère que ce qu’avait connu l’Argentine début 2002.
Autant d’incertitudes systémiques et géopolitiques format XXL qui sont de nature à détourner les investisseurs des marchés d’actions pour plusieurs années. Il faudra y rajouter le renforcement des contrôles puis la peur de voir les règles du jeu changer en cours de partie (comme lors de l’interdiction des ventes à découvert le 18 septembre dernier).
De toute façon, le problème de l’aversion pour la bourse devrait se régler de lui-même : à en croire la presse grand public — mais également économique et satirique — il n’est pas certain qu’il reste encore des banques pour héberger un compte-titres d’ici deux ans !
Philippe Béchade,
Paris
La finance de marché sape l’économie de marché
Pour conclure, il convient de pointer une dernière erreur : la croyance selon laquelle l’économie de marché appellerait une finance de marché.
Les marchés sont faits pour des réalités : les biens et services. Productrices de services, les institutions financières ont naturellement à se positionner sur le marché des services monétaires et financiers. Mais il ne faut pas confondre ce marché avec celui des soi-disant produits financiers.
Soit par exemple le marché des actions. Il a transformé la réalité : être actionnaire d’une société ne signifie plus faire partie d’un ensemble d’associés qui ont mis en commun des ressources pour produire, vendre, faire des bénéfices, créer des emplois, etc. ; exit l’affectio sociÉtatis ! L’intervenant en bourse n’est souvent plus qu’un boutiquier cherchant à vendre au plus cher et à racheter à meilleur prix, ou à défaut à vendre dans les premiers, avant l’effondrement des cours. Les choses ont chassé les relations. L’ampleur des paniques boursières, l’extrême volatilité des cours, en sont pour une bonne part la conséquence.
Regardons maintenant le traitement de la crise. Elle ressemble étrangement à la parabole du débiteur impitoyable (Mt 18 23-35). États et banques centrales, comme le roi de cette allégorie, ont eu pitié de tel établissement en difficulté, lui ont fait crédit, y ont pris une participation. Et que fait-il ? il fait saisir les logements des ménages en difficulté de paiement, les fait vendre aux enchères, provoquant d’épouvantables drames humains. Si l’optique relation financière prévalait sur le mythe actif financier, n’est-ce pas de la solvabilisation des ménages défaillants que les autorités se préoccuperaient en premier lieu, en tant qu’acteurs engagés dans des relations qui se révèlent être de véritables nœuds coulants dans lesquels ils ont imprudemment passé leur cou ? Peut-être 70 milliards de dollars suffiraient-ils pour traiter ainsi le problème à la racine, en sauvant quantité de familles du désespoir, au lieu de 700 requis pour sauver les intermédiaires financiers en rachetant les actifs devenus invendables et en laissant sombrer les malheureux. Oublier les hommes n’est pas seulement un péché ; c’est aussi une erreur conceptuelle et stratégique de premier ordre.
Cela nous ramène à l’esprit de l’exposé de Benoit XVI aux Bernardins : la raison, l’intelligence, sont les meilleurs amis et outils de la foi et de la charité. La finance pâtit, et fait souffrir les hommes, du fait du manque d’envergure intellectuelle de ses organisateurs autant et plus encore que de l’esprit de lucre et de l’indifférence à la misère qui caractérisent trop de ses acteurs.
*Jacques Bichot est économiste, professeur émérite à l’Université Jean-Moulin (Lyon III).
<<mais rien n’interdisait aux republicains d’abolir ces lois. et malgre elles les democrates avaient des excedents budgetaires>>
oui mais à l’époque clintonnienne l’immobilier s’appréciait continuellement., donc pas de problème de subprimes. Le germe empoisonné planté par les socialistes (oups, pardon les démocrates) n’a commencé à porter ses fruits pourris que ces 2 dernières années.
De plus les démocrates avaient profité de l’assainissement budgétaire achevé par R.Reagan. Un peu comme T.Blair qui a profité du coup de balai de Mme Thatcher.
Facile de manger les marrons quand quelqu’un d’autre les a retiré du feu…
les neoliberaux vont accuser clinton et carter
il s’agissait de loger les pauvres
mais rien n’interdisait aux republicains d’abolir ces lois. et malgre elles les democrates avaient des excedents budgetaires.
L’appat du gain facile pour demeurés … heu…reux.
Recevoir de l’argent virtuel, toujours plus, quel bonheur! plus besoin de conscience!
Plus besoin de penser: comme un fonctionnaire! Fonctionnaire dans un capitalisme qui ne connait pas les limites parcequ’il se sent fort.
Comme l’Etat qui ne sent jamais rien des coups qu’il donne. Et qui en vit.
Mais la bêtise appelle le bâton. Voilà qu’ils ont peur. Le spectacle pourrait être savoureux si les vrais coupables payaient seuls leurs erreurs.